Depuis Munich, Werner Herzog, à l’automne 1974, apprend que son amie Lotte Eisner, qui vit à Paris, est très malade, vraisemblablement mourante. Lui vient alors une de ces pensées magiques dont il a le secret, comparable à celles qui innervent tant de ses films et qui semblent croiser aux marges du songe, du mysticisme, de l’extra-lucidité et de la folie : il décide séance tenante de partir la retrouver, en comblant la distance entre Munich et Paris… à pied. C’est le pari d’un croyant, qui se dit sans doute qu’avec cet acte de foi il peut repousser la mort. Tout bien pesé, c’est une hypothèse qui se tient assez bien, un postulat de départ qui s’entend, si on le compare au tombereau de chimères et de fadaises sur lequel tant d’âmes humaines jugent bon de fonder leur rapport au monde.
Étalé sur trois semaines, ce récit d’une centaine de pages est un extrait – au sens chimique du terme – d’un journal de marche rempli au fil de ce très long bout de route, battu dans “la solitude des solitudes”, la froidure (jusqu’à vivre dès la première semaine “l’enténèbrement” de terribles tempêtes de neige) et surtout l’humidité, la pluie (“La pluie c’est à peu près mon seul souvenir. Cela s’est transformé en un ruissellement constant et régulier, sur un ruban sans fin.”).
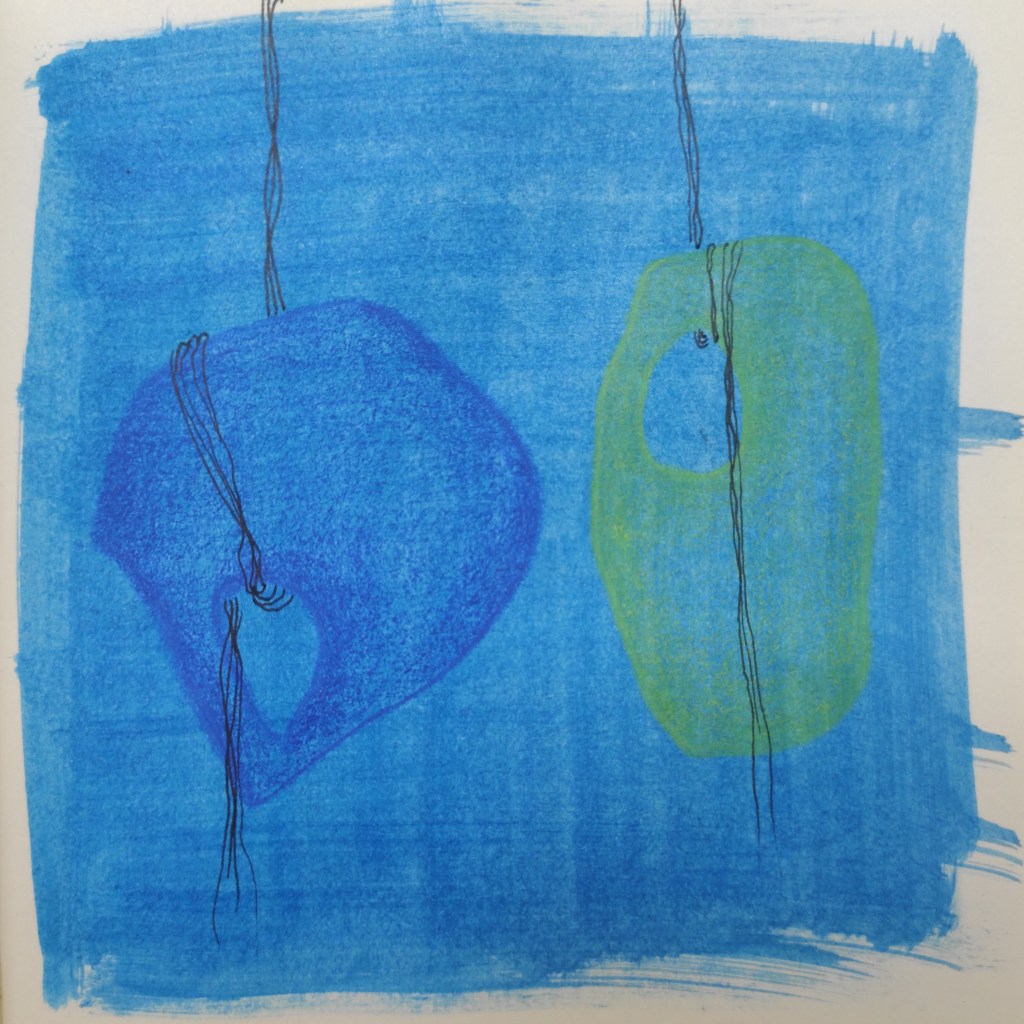
C’est une suite de réflexions-minutes et de descriptions vives, de snapshots chopés à hauteur de vagabond, de micro-événements que les radars de la Grande Littérature ne détectent jamais, de recensements quasi obsessionnels des traces qui strient et grêlent la surface du monde (empreintes de tracteurs, cicatrices boursouflées des labours, monticules de betteraves à sucre, feux divers, objets abandonnés, jetés, perdus). Herzog croise des êtres humains qui s’incarnent soudainement, comme des apparitions (des aubergistes, un curé, des enfants, des paysans, des femmes aux champs ou au travail, un policier, des bûcherons), ou qui se réduisent au contraire à l’état de silhouettes, quasi irréelles ; des animaux domestiques (beaucoup de chiens, des moutons gelés sous la neige, des cochons attroupés, des vaches étonnées, apeurées ou impavides, de vieux chevaux, des canards embourbés) ou sauvages (un renard, des chevreuils, des lièvres), et aussi des oiseaux plus ou moins habiles et farouches (des corneilles à foison, des buses en patrouille et des grues en escadrilles, un faisan, un épervier, des perdrix, une pie-grièche, un pivert). Il longe des auberges et des arrêts de bus, visite des résidences secondaires vides et des granges dans lesquelles passer la nuit (ou encore une caravane d’exposition, qui donne lieu à un paragraphe assez tordant), traverse des paysages plus ou moins habités ou déserts. Se demande où dormir. Consigne l’état de ses pieds, des ampoules qui les constellent et des plaies qui les affligent, de son épuisement général, qui très vite s’impose ; toute une anatomie souffrante, enflée, qui prend de plus en plus de place (aine, cuisse, cheville, tendon d’Achille, pied droit). Achète du sparadrap, de l’alcool camphré. Se demande pourquoi marcher est si douloureux. Déroule toute une litanie d’engins agricoles lacérant la terre, de corbeaux qui filent au ciel, de pluies qui s’abattent comme des coups de sang, de vaches aux prés et de prés détrempés par les eaux d’en haut, de noms de village auxquels aucun autre mot ne vient adhérer. Capture au matin “un soleil sanglant” comme il s’en lève “les jours de bataille”. S’attarde sur la force d’inscription des objets abandonnés – “Je suis fasciné par les vieux paquets de cigarettes sur les bas-côtés de la route, surtout quand ils ne sont pas froissés, qu’ils se gorgent d’eau, et prennent des allures de cadavre.” Et plus loin : “Comme toujours l’œil n’est attiré que par les formes vides : boîtes, choses jetées.”
C’est une traversée pleine de gravité, parce que tout y invite. La fréquentation exclusive de soi, pour commencer, bien sûr – “La solitude est-elle bénéfique ? Oui, assurément. Seulement, elle nous ouvre à des intuitions dramatiques de l’avenir.” La rude nudité d’être qui, tout au long de sa ligne de fuite, escorte le chemineau sans compagnie – “D’elle-même, la vérité marche à travers bois.” Et puis la saison d’hiver, et le ciel éreinté qui laisse tomber tout ce qu’il peut de son fardeau de nuées, et le blanc et noir mouillé des régions arpentées, et l’abandon des villages défaits. “Ici, par négligence, on tue le pays”, lit-on du côté de Domrémy-la-Pucelle. Le monde sensible, que l’hiver amaigrit tant, Herzog le cueille au creux de ses mains, le soutient du regard comme on soutient un infirme, ou un corps agonisant : “Dehors, brouillard, si glacial que les mots me manquent pour le dire. Sur l’étang nage une pellicule de glace. Les oiseaux se réveillent : des bruits.”
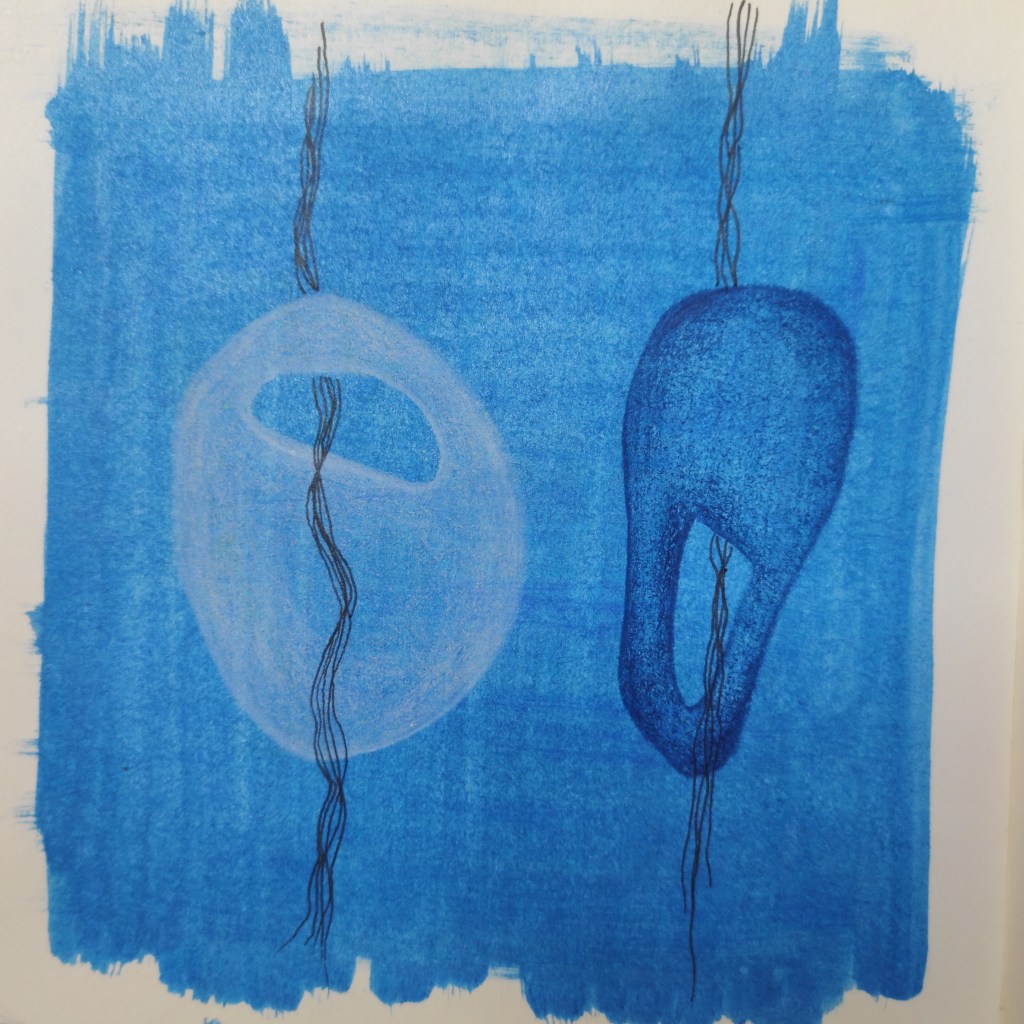
C’est un ouvrage dont le déroulement procède soit par enchaînements naturels, soit par enchevêtrements bruts, presque anarchiques – Herzog n’apporte pas de soin particulier à la cimenterie, pas plus qu’il ne se soucie de la régularité des lignes. Des images frisent l’hallucination, comme cette jeune fille blême qui, du côté de Joinville, s’effondre sur les marches de l’église (“On lui a passé de l’eau fraîche sur les lèvres, mais elle a préféré la mort.”). Ces instantanés ont le vif d’un coup de lame planté au cœur du réel ; lequel réel ne semble jamais palpiter autant qu’au moment où il se laisse transpercer par la lance du regard. Dès les premières pages, par exemple, on lit : “Dans un champ détrempé, un homme prend une femme. L’herbe est couchée et sale.” Et c’est tout, et l’œil s’en trouve comme déshabillé pour le compte – il ne récupèrera ses effets qu’une fois le livre refermé, si toutefois il y tient absolument. Juste en-dessous, paragraphe suivant, ce fol enchaînement, qui pourrait bien résumer toute l’affaire : “Tant de choses passent dans la tête de celui qui marche. Le cerveau : un ouragan. Un accident a failli se produire juste devant moi. J’ai une passion pour les cartes géographiques. Les matches de football commencent : sur des terrains labourés, on trace la ligne médiane.”
Le tout bâtit quand même bel et bien un récit, dont la composition, tour à tour ou simultanément cut et fluide, épouse au fond ce que peut être la voix intérieure du marcheur, nourrie et enrobée de silence : voix qui peut creuser profond son sillon, ou bien tressauter comme un saphir à la surface d’un disque rayé, ou bien encore suivre le fil torsadé d’une rumination sans rime ni raison. C’est la rançon de cette aventure bricolée avec rien, de cette odyssée transie et fauchée. De cette mise en mouvement née d’une simple impulsion, de cet élan confus dicté par le seul instinct de sauver une vie qui lui est chère, Herzog, sans méthode ni théorie mais avec ses cloques aux pieds et ses articulations qui sifflent, tire in fine une manière unique de régler le pas de la pensée et de l’écriture sur celui du monde. Et de cette mise en écho contingente, de cette synchronisation subreptice, surgit l’idée que l’homme et ledit monde pourraient donc – fugitivement, le temps que prend la traversée de quelques paysages – se faire mutuellement poètes, à défaut d’être amis. “Qu’est-ce qui occupe les gens ? Les caravanes, les voitures accidentées que l’on rachète, la laverie-minute ? Concentrer ma pensée sur moi m’a conduit à une découverte : le reste du monde rime.”
Werner Herzog, Sur le chemin des glaces – Munich-Paris du 23.11 au 14.12.1974, [Vom Gehen im Eis, Carl Hanser Verlag, 1978]. Première édition française par P.O.L./Hachette, coll. “Bibliothèque allemande”, 1979, traduction Anne Dutter. Rééditions par P.O.L. (1988) et, en poche, par Payot & Rivages, coll. “Petite Biblio Payot Voyageurs” (1996).

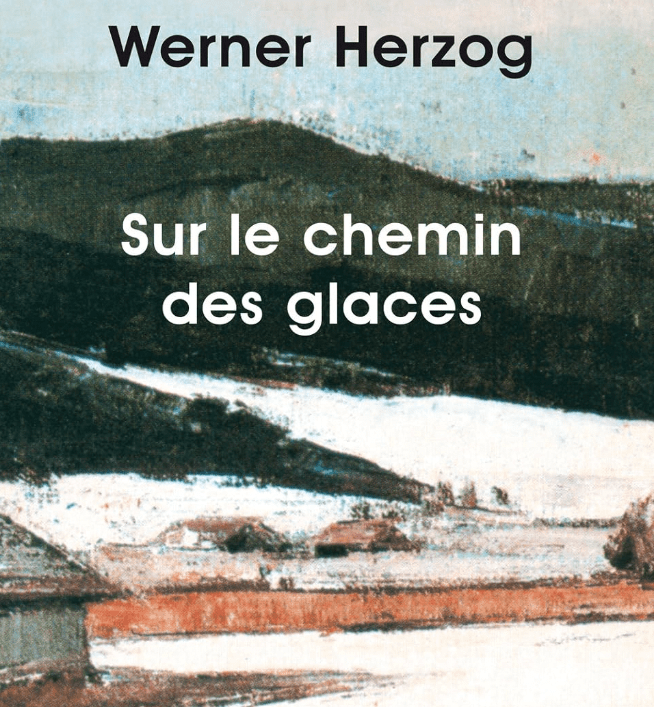
Laisser un commentaire